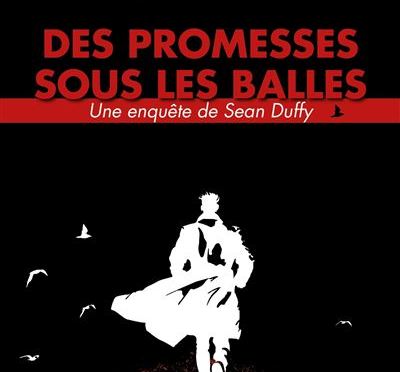Editeur : Gallimard Série Noire (Grand Format et format poche) ; Livre de Poche (Intégrale en format poche)
Traducteurs : Isabelle Artega et Patrice Carrer
Les titres de la rubrique Oldies de l’année 2023 sont consacrés aux éditions du Livre de Poche pour fêter leurs 70 années d’existence.
Attention, coup de cœur !
Adrian McKinty, remarqué pour son thriller La Chaine et sa série ayant pour personnage principal Sean Duffy, inspecteur de police catholique en Irlande, avait commencé sa carrière avec une trilogie mettant en scène Michael Forsythe, un jeune irlandais obligé d’immigrer aux Etats Unis et intégrant la mafia irlandaise. Pour la première fois, un recueil regroupe au format poche les trois tomes de la trilogie, A l’automne, je serai peut-être mort, Le fils de la mort, et Retour de flammes.
L’auteur :
Adrian McKinty, né le 6 août 1968 à Belfast, en Irlande du Nord, est un écrivain irlandais, auteur de roman policier et de littérature d’enfance et de jeunesse.
Il grandit à Carrickfergus, dans le comté d’Antrim (Irlande), sur la côte est de l’Irlande du Nord. Il étudie le droit à l’Université de Warwick, puis les sciences politiques et la philosophie à l’Université d’Oxford.
Au début des années 1990, il déménage aux États-Unis, vivant d’abord à Harlem, le quartier noir de Manhattan, à New York. En 1998, il fait paraître son premier roman intitulé Orange Rhymes With Everything.
À partir de 2001, il s’installe à Denver, au Colorado, où il enseigne l’anglais au secondaire et continue à écrire des fictions. À partir de 2004, il se lance dans le roman noir avec À l’automne, je serai peut-être mort (Dead I Well May Be), premier titre d’une trilogie ayant pour héros Michael Forsythe, un ancien agent du FBI, autrefois responsable de l’arrestation d’un gang de mafieux de Boston et qui tente maintenant de refaire sa vie en Irlande du Nord. Cette trilogie place McKinty parmi les représentants de la nouvelle vague du polar irlandais, aux côtés de Ken Bruen, Declan Hughes et John Connolly. Le journal britannique The Guardian le considère même comme un « maître du roman noir moderne, non loin de Dennis Lehane ». Pourtant, les romans de McKinty rappellent plutôt ceux de James Ellroy, en raison d’un recours fréquent et explicite à la violence, et ceux d’Elmore Leonard pour la présence en filigrane de l’ironie et de l’humour noir dans l’évocation lyrique de ses sombres univers.
En 2012, il amorce une série de romans policiers historiques située pendant les « Troubles » des années 1980 et ayant pour héros le sergent Sean Duffy, un flic catholique en plein Ulster. Dans Une terre si froide (The Cold Cold Ground), le premier titre de la série, peu après le décès de Bobby Sands, deux homosexuels sont assassinés et le meurtrier mutile les cadavres et arrache leur main gauche. Tous les enquêteurs croient qu’il s’agit d’un serial killer, mais Duffy flaire une solution plus paradoxale. Avec le cinquième roman de cette série, Rain Dogs, parue en 2016, il est lauréat du prix Edgar-Allan-Poe 2017 du meilleur livre de poche original.
En parallèle à ses récits criminels, McKinty publie, à partir de 2006, des ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse avec la trilogie The Lighthouse.
A l’automne, je serai peut-être mort :
Michael est un jeune Irlandais peu scrupuleux, qui émigre aux États-Unis. Pour survivre, il entre au service d’un gangster pour le compte duquel il accomplit de sordides missions punitives. Il convoite bientôt la maîtresse de son patron, dont il est tombé amoureux. La belle, qui n’est pas née de la dernière pluie, cède sans résister. Un crime impardonnable ! Devenu soudain l’objet d’une vengeance plus que vicieuse, Michael, avec quelques camarades, se retrouve brutalement plongé en enfer, c’est-à-dire au fond d’une immonde prison mexicaine où la police les jette sur la base d’une accusation fallacieuse. Dans Cette bâtisse construite au milieu d’une jungle marécageuse, l’horreur s’installe, car les conditions de vie s’y révèlent infectes et dangereuses. On les passe à tabac. L’épuisement les gagne. Michael n’a qu’une idée : s’échapper à tout prix pour venger ses amis, dût-il en être à jamais marqué dans sa chair…
Le fils de la mort :
Le Fils de la Mort s’ouvre sur une émeute entre hooligans anglais et irlandais à l’issue d’un match de football en Espagne. En vacances sur place, Michael Forsythe, un ancien malfrat retourné par le FBI ayant permis l’arrestation d’un gang de mafieux bostoniens, est arrêté en marge de ces violences. Alors qu’il risque une lourde peine de prison, une agente des services secrets britanniques du MI6 lui propose un marché qu’il ne peut refuser s’il veut retrouver un jour la liberté. Nous sommes en 1997 et l’IRA est sur le point d’annoncer un cessez-le-feu avec les forces armées britanniques. Le MI6 soupçonne certaines cellules dormantes établies aux Etats-Unis de refuser cet état de fait et de lancer une campagne terroriste sur le sol américain. La mission de Michael est simple : infiltrer les « Fils de Cuchulainn », un groupe de vieux Irlandais en exil basé dans les environs de Boston. Tout semble se passer pour le mieux jusqu’à ce que Michael tombe amoureux de la fille de Gerry McCaghan, le leader du groupe…
Retour de flammes :
Tous ceux qui ont croisé son chemin vous le diront : Michael Forsythe est increvable. Mais cela ne semble malheureusement pas décourager les mauvaises volontés de ses poursuivants qui veulent lui faire la peau depuis qu’il a témoigné une dizaine d’années plus tôt contre la mafia irlandaise de Boston.
Caché par le FBI dans le cadre du programme de protection des témoins, Michael vit sous une fausse identité dans la ville de Lima, au Pérou. Mais Bridget Callaghan, dont il a abattu le fiancé douze ans plus tôt et qui a repris les rênes de la mafia de Boston, a réussi à retrouver sa trace.
Aussi, quand ses tueurs tendent le téléphone à Michael pour qu’il lui parle, croit-il qu’elle souhaite simplement le narguer ?
En réalité, plongée dans le désespoir par la disparition de sa fille, Bridget veut donner à Michael une occasion de se racheter. Tout ce qu’il a à faire, c’est rentrer en Irlande et retrouver sa gosse, qui vient de se faire kidnapper. S’il la sauve, il pourra vivre. Il ne lui reste plus que 24 heures chrono…
Mon avis :
Ce recueil nous propose les aventures de Michael Forsythe au complet, soit une trilogie complète au prix d’un grand format, 1500 pages soit trois livres pour le prix d’un. Déjà, chaque tome en vaut la peine, alors quand on nous en propose trois, le rapport Qualité / Prix est indéniable. Comprenons-nous bien, ces romans s’adressent aux fans de hard-boiled, de romans d’action violents non dénués d’émotions extrêmes, ni d’humour froid et cynique typiquement irlandais.
Même si les quatrièmes de couverture dévoilent beaucoup d’éléments de l’intrigue, il faut vraiment lire les romans pour en apprécier le ton donné par l’auteur et l’évolution du personnage lors de ces trois aventures, et se laisser malmener par le rythme incessant additionné à la paranoïa de Michael Forsythe. Et vous placerez ce personnage parmi les inoubliables de la littérature noire.
Dans A l’automne, je serai peut-être mort, l’histoire commence en Irlande dans les années 80. Etant catholique, Forsythe n’a pas le droit d’occuper deux métiers pour vivre. Alors qu’il trouve un boulot de serveur dans une réception mondaine, un photographe l’immortalise au second plan et cette photo finit par être publiée dans les journaux. Pour éviter la prison, il n’a d’autres choix que d’immigrer aux Etats-Unis où un oncle se chargera de lui trouver un travail, qui s’avère lié à la mafia irlandaise. Son humour et sa faculté de se lier aux autres vont lui permettre de progresser dans la hiérarchie jusqu’à ce qu’il rencontre la future femme du parrain pour qui il travaille.
Le fils de la mort nous montre Forsythe en fuite après sa vengeance sanglante et son statut de traitre. Il a en effet passé un marché avec le FBI et devient un témoin protégé avec une nouvelle identité. Mais sa tête est mise à prix par la mafia irlandaise dirigée par son ex-amante et par la police mexicaine, après s’être échappé de leur geôle. Il doit malgré tout reprendre du service pour le compte du MI6.
Retour de flammes clôt ce triptyque avec logique et fureur. Depuis l’épisode précédent, ses seuls ennemis sont la mafia irlandaise pour laquelle il a travaillé à son arrivée aux Etats-Unis. Une opportunité va lui permettre d’envisager une nouvelle vie propre mais elle sera dangereuse et bien sanglante.
Si dans le premier tome, on découvre un jeune homme immature et ne comprenant pas le milieu dans lequel il nage, on adore son humour, et son sens de la débrouille. Son passage dans les geôles mexicaines va le transformer en monstre de vengeance, sans foi ni loi, ne se posant jamais la question et n’hésitant pas à foncer droit devant. Et cette première aventure est une sacrée découverte.
A partir du deuxième tome, on le découvre paranoïaque, ne se liant avec personne car il existe un risque que chaque personne soit un traitre prêt à le tuer. Sa réponse est toujours immédiate, la mort. Ce deuxième tome est un vrai coup de cœur, tant par le rythme que par les dialogues, et on le suit dans son périple sanglant, luttant pour l’espoir que son casier judiciaire soit lavé. On fond aussi devant les sentiments qu’il ressent envers l’agente de MI6 et qui nous donne la possibilité de lire des scènes effroyablement émotionnelles.
Le troisième tome clôt de magistrale façon cette trilogie, en reprenant les qualités des deux premières aventures et en renvoyant Forsythe dans son pays natal, un pays déchiré par des clans à la recherche de tous les moyens pour gagner de l’argent. Comme pour toutes les autres aventures, Forsythe est malmené, torturé, obligé d’employer des moyens extrêmes et se conclut dans une scène dans le brouillard inoubliable.
Avec cette trilogie, Adrian McKinty mettait le pas dans le monde du roman noir violent, n’hésitant pas à créer des scènes ultra-violentes à coté de dialogues d’une drôlerie rare, avec cet humour froid que l’on adore chez les auteurs irlandais. Le rythme est incessant, le personnage intéressant et cette trilogie un incontournable pour les amateurs de romans d’action. Enfin, on comprend mieux la genèse du personnage de Sean Duffy qu’il créera juste après.
Coup de cœur !