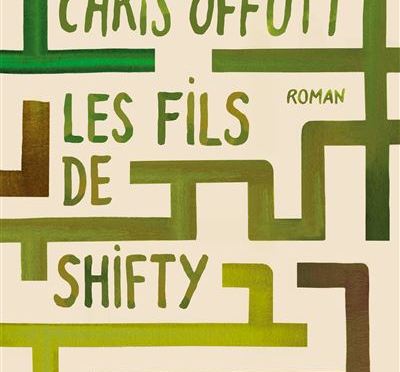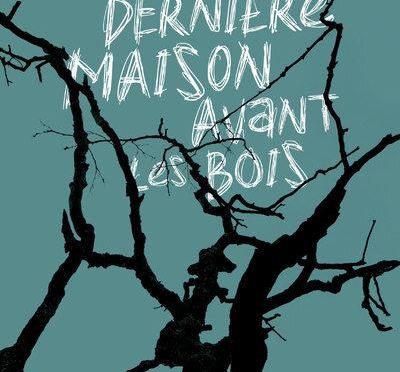Editeur : Gallmeister
Traducteur : Anatole Pons-Reumaux
Après le formidable premier tome de cette trilogie, Les gens des collines, voici donc la suite qui est tout aussi passionnante.
Mick Hardin, membre du Criminal Investigation Division de l’armée, est toujours en permission dans sa ville natale de Rocksalt dans le Kentucky. Il se remet d’un attentat à l’explosif qui l’a blessé à la jambe. Sa sœur Linda le loge alors qu’elle doit préparer sa réélection au poste de shérif. Il reste une semaine à Hardin avant son retour et il continue à consommer des médicaments antidouleurs. Il doit aussi faire face à la demande de divorce de sa femme qui vient d’avoir un bébé avec un autre homme.
Un chauffeur de taxi découvre sur un parking de supermarché abandonné le cadavre d’un homme criblé de balles. Mick et Linda se rendent sur place et s’aperçoivent que le corps a été déplacé, vue la faible quantité de sang sur place. Linda identifie rapidement le mort, Barney « Fucking » Shifty, un dealer d’héroïne du coin. Pour la police, il s’agit sans aucun doute d’un règlement de comptes entre trafiquants, donc il est inutile d’enquêter.
Alors que Linda doit assurer sa campagne pour sa réélection au poste de shérif, visiter les gens, distribuer des tracts, planter des pancartes, elle demande à Mick d’aller annoncer la nouvelle de la mort de son fils à la veuve Shifty. Celle-ci propose à Mick de l’argent pour qu’il identifie les assassins, ce que Mick refuse. Par contre, il voit dans cette enquête la possibilité d’aider sa sœur et de s’occuper l’esprit pour éviter de prendre ses médicaments addictifs, tels que l’oxycodone. Bientôt, c’est Mason, le deuxième fils Shifty qui est abattu.
Autant vous rassurer tout de suite, il n’est pas nécessaire d’avoir lu le précédent roman de cette trilogie (Les gens des collines) avant d’attaquer celui-ci. Cela vous permettra juste de vous retrouver en terrain connu et de retrouver certains personnages, surtout ceux du bureau du shérif.
Car dans cette enquête, Chris Offutt nous présente d’autres personnages (dits secondaires) comme si on les connaissait depuis toujours. Il possède ce talent de nous immerger dans la vie d’une petite ville où tout le monde se connait, au milieu d’un paysage magnifique et va nous décrire tous les trafics qui s’y déroulent. On a toujours, au détour d’une scène, une phrase magique pour faire le parallèle entre la beauté de la nature (faune ou flore) et la laideur des hommes occupés à gagner leur argent salement.
Par contre, on ressent beaucoup de tendresse envers les habitants honnêtes de cette contrée. Je prendrai comme exemple Jacky Merle, l’inventeur fou qui s’enferme dans son garage pour sortir des innovations qui faciliteront la vie de tout un chacun. Chris Offutt nous parle aussi du rôle de proximité du shérif, sa présence nécessaire pour rassurer les habitants ou même les petits problèmes auxquels Linda doit faire face comme cette fois où elle doit récupérer un chien qui a sauté d’un balcon.
Outre l’intrigue menée de façon remarquablement maitrisée, Chris Offutt met en valeur les zones rurales des Etats-Unis où l’ambiance est plutôt calme, où l’économie est en berne, où les gens survivent dans la précarité et où, sous la surface, apparaissent toutes sortes de trafics (drogues ou autres) en parallèle de ceux légaux (les médicaments addictifs). On y voit aussi des gens du cru, habitués à une vie dure, taiseux, parlant d’un hochement de tête qui remplacent des phrases inutiles.
Jamais misérabiliste ni défaitiste, Chris Offutt reste toujours factuel et nous dépeint une Amérique à deux vitesses, loin de celle des riches des villes. On y sent une fracture évidente en se concentrant sur ceux qui n’ont rien et qui se débrouillent pour survivre, tout en montrant combien la nature peut être si belle devant les saloperies dont sont capables les hommes. On gardera longtemps en mémoire ce voyage dans les paysages magnifiques du Kentucky, avec l’impression d’avoir côtoyé ses habitants, un sacré coup de force.